Dans le cadre du Mois national de l’histoire autochtone, Impact Campus est de retour avec ses suggestions de lectures pour célébrer l’initiative de Daniel et Cassandre Sioui En juin : Je lis autochtone ! Du recueil de poésie bilingue à l’essai féministe, de la science-fiction post-apocalyptique au théâtre poétique, découvrez ces littératures, plutôt ces arts narratifs autochtones comme autant de nations, de communautés, de visions du monde. Notez qu’Impact a encore une fois décidé de faire tirer les oeuvres présentées. Pour participer, c’est par ici. Bonne chance et bonnes lectures !
Par Frédérik Dompierre-Beaulieu (elle), journaliste multiplateforme
N.D.L.R. Bien que juin soit une merveilleuse occasion de mettre à l’avant-plan les questions des droits autochtones au Québec et au Canada, l’histoire et la culture des différentes nations et, dans ce cas précis, les auteur.rices, libraires et éditeur.rices autochtones, il faut se rappeler que ce n’est ni un simple effet de mode, ni un événement ponctuel. C’est encore moins une excuse pour justifier son tokenisme (ou diversité / inclusion / inclusivité de façade). L’écoute et l’ouverture, ça se pratique à l’année. Voilà, c’est dit.
ᓄᓈᐱᒐ / Nunaapiga / Mon cher petit territoire – Collectif Inuit – Hannenorak – Poésie
Résumé / Quatrième de couverture : Les poèmes de ᓄᓈᐱᒐ / Nunaapiga / Mon cher petit territoire ont été écrits en inuktitut par des Inuit lors d’ateliers d’écriture tenus à la maison de la famille d’Inukjuak au Nunavik et au centre Ivirtivik de Montréal. Ils ont été recueillis et traduits dans le cadre du projet Inuktitut Uqatsianguarutiit, coordonné par les Productions de brousse. « Ces poèmes m’ont donné l’impression d’être à la maison. […] Je chérirai ces moments que nous avons vécus, ces textes que nous avons écrits. Nous étions ensemble. »
Avis : Ce que j’aime des oeuvres bilingues en version miroir, c’est justement cette tentative de rapprochement, voir de résistance et d’affirmation par le langage, qui convoque des représentations recadrées et porte en lui un rapport au sensible qui lui est propre. J’aurais aimé pouvoir lire l’inuktitut pour avoir accès aux poèmes originaux, comme ils ont initialement été pensés et écrits – parce que la traduction ne pourra jamais rendre compte à 100% de la version initiale – cela ne m’a certainement pas empêchée d’apprécier ma lecture, cependant. Les poèmes y sont simples, dénudés de toutes fioritures, mais les paroles qu’ils donnent à lire y sont aussi vraies et restituent, par ce recueil et au fil de ses brefs portraits par fragments, une rencontre autrement trop souvent manquée.
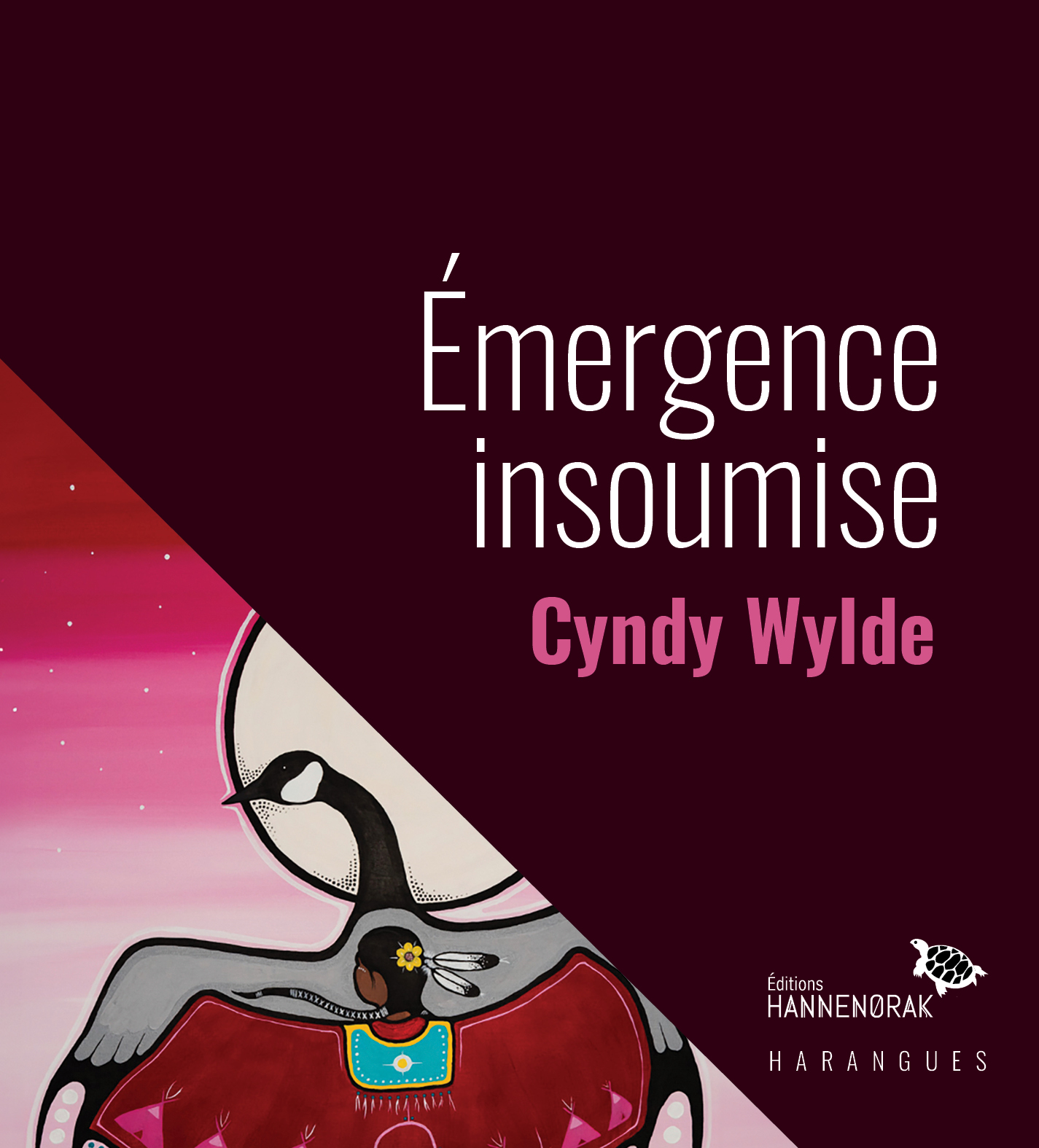 Émergence insoumise – Cyndy Wylde – Hannenorak – Essai
Émergence insoumise – Cyndy Wylde – Hannenorak – Essai
Résumé / Quatrième de couverture : Émergence insoumise s’ouvre sur un souvenir de l’autrice qui attend un taxi après un cours : « Non, mais croyez-vous vraiment que moi, une femme des Premières Nations, je vais aller attendre seule le soir, à Val-d’Or? » Ces mots, adressés au gardien qui lui indique que les portes de l’université sont sur le point de fermer, seront le catalyseur d’une réflexion sur le sort réservé aux femmes autochtones, aussi bien dans le milieu carcéral que dans la société canadienne en général.
Avis : C’est toujours pertinent, en tant que féministe, d’être confrontée à des enjeux et des questions avec lesquelles nous ne sommes pas familie.ères, et c’est d’autant plus vrai pour les femmes autochtones que l’Histoire et les médias ont encore tenté de maltraiter, d’invisibiliser, de décrédibiliser, femmes dont l’image manipulée est surtout venue conforter une pensée colonisatrice destructrice. Dans cet essai, Cyndy Wylde alimente une réflexion qui s’appuie certes sur des statistiques et des études de cas, mais la démarche en elle-même participe d’une valorisation de l’expérience individuelle et personnelle comme porteuse d’un savoir valide et non négligeable. Bien que l’oeuvre soit courte, elle n’en est pas moins percutante. Les horreurs dont elle s’indigne choquent, inspirent la colère, mais aussi, et surtout, incitent à la remise en question. L’autrice nous y tend la main ; parce qu’une sensibilité intersectionnelle, entre autres, ça s’apprend et ça se développe, se (dé)construit et se reconstruit.
 Neige des lunes brisées – Waubgeshig Rice – Mémoire d’encrier – Roman (science-fiction / horreur)
Neige des lunes brisées – Waubgeshig Rice – Mémoire d’encrier – Roman (science-fiction / horreur)
Résumé / Quatrième de couverture : Quand une société s’effondre, une autre renaît. Une petite communauté anishinaabe est plongée dans le noir, alors que l’hiver s’annonce. Plus d’électricité ni de moyens de communication. L’arrivée inopinée de visiteurs fuyant l’effondrement de la société dans le Sud attise les tensions et divise les allégeances. Les mois durs de l’hiver s’éternisent, la pénurie de nourriture s’aggrave et s’accumulent les cadavres. La véritable menace, pourtant, pourrait bien survenir du cœur même de la communauté.
Avis : La plus longue des quatre oeuvres suggérées, j’ai pourtant lu ce roman dystopique presque d’une seule traite. Et ce n’est pas pour venter mon privilège de pouvoir m’arrêter et consacrer une si longue période ininterrompue de mon temps libre que je le mentionne, mais plutôt pour souligner la manière dont l’auteur réussit à nous ravir à nous-mêmes en nous transportant dans une communauté dont le quotidien bousculé malgré elle oscille entre l’ordinaire et l’inhabituel, l’anecdote et l’exceptionnel. Ce roman, c’est aussi une sorte de mise sur pause : le rythme y est relativement lent, nous permet de bien nous asseoir, tout en nous gardant, et là réside l’une de ses forces, bien au bout de notre siège. Loin de faire dans une science-fiction qui se voudrait hyperfuturiste, surréaliste et vertigineuse, le récit est assez réaliste pour que l’on puisse nous-mêmes s’y imaginer. Qu’on profite d’un jour de tempête pour bien se calfeutrer et le dévorer et le tour est joué!
 Akuteu – Soleil Launière – Remue-Ménage – Théâtre
Akuteu – Soleil Launière – Remue-Ménage – Théâtre
Résumé / Quatrième de couverture : Akuteu: «suspendu», en langue innue. Filant la métaphore de la carcasse de l’animal que l’on suspend, Soleil Launière raconte le vertige d’être en perpétuelle suspension, entre la fierté et la honte, entre les mondes du visible et de l’invisible. Est-il légitime de prendre la parole au nom des siens? Comment démêler l’inextricable nœud dont est faite l’identité?
Avis : Ce que j’aurai retenu de cette lecture, outre sa relation poétique et non conventionnelle à ce qui se veut être du théâtre – vous comprendrez assurément quand vous l’aurez entre vos mains -, ça aura été cette question du mouvement puis du cycle, comme le dit si bien l’autrice, mais également celle du corps. Le corps en ce qu’il est lourd, en ce qu’il porte une mémoire, des blessures tout comme des promesses, et plus encore l’ambivalence, sous toutes ses formes : il y a là une oeuvre en clair-obscur qui ne craint pas de déterrer et de nommer, sans non plus prétendre à résoudre les tensions qui l’habitent. Mon seul regret : ne pas avoir pu en voir l’incarnation, sur scène ou ailleurs. Une prochaine fois peut-être.
Pour les curieux.euses, on en profite pour vous joindre la liste d’oeuvres autochtones francophones éditées au Canada.
Ici, on vous présente plutôt en quatre parties nos recommandations de l’année dernière, qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres !



